Les prétentions hégémoniques et les armes des États-Unis n’apportent ni l’ordre ni la paix
Michael von der Schulenburg a été sous-secrétaire général des Nations unies et a travaillé pendant plus de 34 ans dans de nombreuses zones de guerre à travers le monde, jouant un rôle de premier plan dans les missions de paix des Nations unies. Il a récemment été élu au Parlement européen pour la circonscription de Bündnis Sahra Wagenknecht
Read the English version HERE
Lesen Sie die deutsche Fassung HIER
Leggi la versione italiana QUI
A magyar változatot ITT olvashatja
Avec la guerre en Ukraine, peut-être devrions-nous nous reposer la question la plus importante pour un avenir pacifique de l’humanité : un monde, dans lequel la paix et un ordre international serait garanti par des accords entre les États, peut-il exister ou bien y aura-t-il un seul et unique ordre qui imposera son pouvoir hégémonique par la violence militaire, économique et politique ? C’est la question de savoir si nous vivrons dans un monde où règne le droit du plus fort ou finalement celui du droit international. Quelques réflexions à ce propos.
Dans la guerre en Ukraine, les pays de l’OTAN se présentent comme les défenseurs du droit international et d’un « ordre international » – sans que celui-ci soit plus précisément défini, contre une Russie qui, en envahissant l’Ukraine, a enfreint de manière éclatante le droit international, détruisant ainsi l’ordre international. Mais est-ce bien aussi simple ? Ne serait-ce pas plutôt que tous les belligérants, dont font également partie les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN, auraient enfreint de multiples fois le droit international, et voire même violé ?
Et ce n’est pas tout. Si toutes les parties en guerre avaient respecté le droit international existant, cette guerre aurait pu être évitée. Une incommensurable souffrance humaine avec la mort et les mutilations aussi bien physiques que morales de centaines de milliers de personnes de part et d’autre du front auraient été évitées. L’Ukraine n’aurait pas été précipitée au bord de l’abîme par la destruction, la division interne, l’appauvrissement, l’endettement et un dépeuplement qui va en s’accentuant, et continuerait d’exister dans les frontières de 1991. Et l’humanité ne se verrait pas confrontée au risque d’un conflit nucléaire, probablement le plus grand depuis la guerre froide.
Il ne sera pas question dans cet article de statuer quand la guerre a commencé ou qui en porte la plus grande responsabilité. Mais l’exemple de la guerre en Ukraine pointera l’importance capitale d’un droit international se basant sur la charte des Nations unies pour le maintien d’un ordre mondial plus pacifique. Si nous voulons établir une paix mondiale sans violence armée, cela ne peut se produire qu’en empruntant le chemin d’un droit international reconnu par tous.
Le reproche de la violation du droit international
Dans les pays de l’OTAN, le reproche de la guerre d’agression de la Russie, contraire au droit international, et le droit de légitime défense qui en découle, monopolise toutes les discussions tournant autour de la guerre en Ukraine. C’est cette invocation du droit international, au demeurant incontestée, avec laquelle les États de l’OTAN justifient leur rôle militaire dans la guerre en Ukraine.
Le reproche de la violation du droit international se réfère à la Charte des Nations unies. Et c’est exact ; dans la charte, tous les États membres se sont engagés à ne pas employer de violence militaire pour imposer des objectifs politiques (article 2/4), et en cas d’agression, chaque État membre a le droit de légitime défense individuelle et collective (article 51). L’invasion russe en Ukraine était donc contraire au droit international. Cela autorise l’Ukraine à se défendre et les États de l’OTAN à soutenir militairement l’Ukraine.
La seule différence : peut-on également justifier par la Charte des Nations unies de mener une guerre pendant plusieurs années qui pourrait s’achever sur la destruction de l’État attaqué ? Et cela justifie-t-il aussi une extension de la guerre à la Russie, au risque de provoquer une guerre nucléaire mondiale ? Et tout cela sans la moindre tentative de résoudre le conflit qui a conduit à cette guerre ? Certainement pas ! Car le sens et la finalité de la Charte des Nations unies est de préserver la paix pour les humains et non de légitimer des guerres. C’est d’ailleurs sur cet appel que débute le préambule de la Charte : « NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS à préserver les générations futures du fléau de la guerre…». Cela devrait être également valable pour la guerre en Ukraine.
L’offre de paix de la Charte des Nations unies
C’est justement l’offre de paix de la Charte des Nations unies qui inclut une interdiction d’utiliser la violence et non le contraire. Comme on peut le lire tout au début, l’objectif des Nations unies est de « Maintenir la paix et la sécurité internationales (…) et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ; … » (article 1/1). D nombreux appels similaires à régler les conflits grâce à des négociations y figurent en grand nombre.
Dans le cas du conflit en Ukraine, cela n’a toutefois pas eu lieu. Il s’agit en l’occurrence d’un conflit d’intérêts contraires en matière d’ordre sécuritaire entre États, connu depuis longtemps (et pas « d’antécédents », comme on le prétend souvent en Allemagne en minimisant la situation). C’est donc un conflit typique qui aurait dû être résolu de manière diplomatique, dans l’esprit de la Charte des Nations unies – et aurait pu l’être ! Car dès 1997, la Russie a clairement exposé à plusieurs reprises qu’elle considérait un élargissement de l’OTAN en Ukraine et en mer Noire directement à ses frontières comme une menace. Mais les offres de négociations de la Russie ont été repoussées par les États-Unis et les États de l’OTAN. En revanche, depuis 2008, l’OTAN a travaillé par tous les moyens à l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN, accentuant ainsi la pression sur la Russie. Tous les accords de limitation des armements et les mesures renforçant la confiance ont été annulés, quant à la capacité de frappe secondaire de la Russie, des systèmes anti-missiles stationnés en Roumanie et en Pologne l’ont restreinte. L’OTAN a exercé de nombreuses fois des manœuvres militaires sur le territoire ukrainien et en mer Noire, et depuis 2014 a ouvertement soutenu la chute armée du président ukrainien élu démocratiquement, afin d’instaurer à Kiev un gouvernement favorable à l’OTAN. Avec les accords de Minsk, l’Ouest ne visait pas la résolution du conflit, mais voulait simplement gagner du temps pour permettre à l’Ukraine de s’armer. Les États de l’OTAN empruntaient ainsi une voie qui rendait une résolution pacifique, telle que la prône la Charte des Nations unies, de plus en plus improbable.
L’argument que l’entrée de l’Ukraine à l’OTAN ne serait pas un objet de négociation puisque l’Ukraine pouvait choisir librement ses accords de sécurité, n’est en fait pas correct non plus. Car dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe de l’OCSE – qui est elle aussi un accord contractuel de droit international – tous les pays européens ainsi que les États-Unis et le Canada déclaraient dès 1990 que : « La sécurité [sur le continent européen] est indivisible et la sécurité de chaque État participant est liée de manière indissociable à celle de tous les autres. » Dans le document d’Istanbul de l’OCSE de 1999, cela a été précisément détaillé : « Chaque État participant respectera les droits de tous les autres à ces égards [il s’agit des arrangements de sécurité]. Aucun État ne renforcera sa sécurité aux dépens de la sécurité des autres États. »
Entraver une résolution pacifique
Si une guerre devait arriver, les États membres des Nations unies seraient également obligés de passer par des négociations pour trouver une résolution pacifique. Dans le cas de la guerre en Ukraine, la Russie et l’Ukraine s’y sont tenues. Trois jours seulement après le début de l’invasion russe, des équipes de négociateurs russes et ukrainiens s’étaient réunies, et à peine six semaines plus tard, les deux camps s’étaient accordés à Istanbul le 29 mars 2022 sur un communiqué de dix points qui présentait la structure de base d’un accord de paix russo-ukrainien global.
Ce communiqué n’a toutefois pas conduit à un traité de paix. Car peu de jours avant, le 24 mars 2022, l’OTAN avait déclaré lors d’un sommet spécial à Bruxelles qu’elle ne soutiendrait pas de telles négociations de paix. Lorsque le président Zelensky s’obstina à tenir au communiqué d’Istanbul, le Premier ministre britannique Boris Johnson effectua une visite surprise à Kiev le 9 avril 2022, lors de laquelle il fit comprendre clairement aux Ukrainiens qu’ils perdraient tout soutien de l’Ouest s’ils signaient un accord de paix avec la Russie.
Le 26 avril 2022, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, déclarait que, dorénavant, l’objectif des États-Unis dans la guerre en Ukraine était le suivant : « Nous voulons affaiblir la Russie de telle façon à ce qu’elle ne soit plus jamais en mesure de faire ce qu’elle a fait en envahissant l’Ukraine. » Ce faisant, les États-Unis avaient alors énoncé un objectif politique dans la guerre en Ukraine, qu’ils voulaient faire aboutir en employant des moyens militaires. Ne reproduisent-ils pas ici exactement ce qu’ils reprochent à la Russie ? Seulement la conséquence fut que toute occasion d’une paix précoce et globale était désormais manquée, et que l’Ukraine sombra dans une guerre qui pourrait à présent menacer sa simple existence.
Si les États de l’OTAN s’étaient placés derrière les négociations de paix russo-ukrainiennes de mars/avril dans le sens de la Charte de Nations Unie, cette guerre aurait pu être liquidée au plus tard en deux mois – et ceci dans de meilleures conditions pour l’Ukraine qu’elles ne pourraient l’être aujourd’hui.
Le principe de souveraineté réciproque
La reconnaissance réciproque de la souveraineté était un pilier des règlements de la Paix de Westphalie et l’est toujours aujourd’hui. Dans la Charte des Nations unies, elle est ancrée sous le principe d’« égalité souveraine » (dans le texte original : « principle of sovereign equality » dans l’article 2/1). Cela signifie que chaque État a le droit de choisir lui-même son ordre politique et de régler lui-même ses affaires internes sans que d’autres États s’immiscent. Ce principe a été violé de façon éclatante dans le conflit en Ukraine.
Selon les déclarations de l’ancienne secrétaire d’État aux Affaires étrangères américaine, Victoria Nuland, les États-Unis avaient investi cinq milliards de dollars dans l’« orientation occidentale » du pays. Pour l’un des pays les plus pauvres d’Europe, c’était une somme énorme. Il est toutefois probable qu’il s’agisse même de montants beaucoup plus élevés (comme des fonds en provenance d’autres États de l’Ouest et de leurs services secrets ainsi que de fondations privées). Les hommes politiques occidentaux se sont aussi mêlés aux manifestants partiellement armés – l’ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Guido Westerwelle, en faisait partie – sur la place Maïdan à Kiev en les assurant de leur soutien – un procédé pour le moins singulier qu’aucun pays occidental n’accepterait à son égard.
Dans une conversation interceptée entre Nuland et l’ancien ambassadeur des États-Unis à Kiev, il a même été discuté quel homme politique particulièrement acquis aux États-Unis devrait être fait ministre-président après un coup d’État réussi. Et c’est exactement ce qui s’est passé., Qu’un président élu démocratiquement comme Ianoukovytch ait été destitué, issu d’élections nationales, qui avaient été à l’époque désignées comme étant libres et fairplay par l’OCSE et l’UE, n’a semblé déranger personne à l’Ouest. Sans cette ingérence contraire au droit international dans les affaires internes, il n’y aurait probablement pas eu de coup d’État illégal, pas de troubles dans de nombreuses régions de l’Ukraine et pas de séparation de la Crimée et du Donbass.
Le principe d’universalité
Mais ce qu’il y a peut-être de plus étonnant dans ce reproche venu de l’Ouest, que la Russie mène un guerre d’attaque contraire au droit international, c’est que justement les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN n’ont cessé de mener eux-mêmes, depuis la fin de la guerre froide, des guerres d’attaque contraires au droit international. Nous nous souvenons encore des guerres contraires au droit international contre la Serbie (1999), contre l’Iraq (2003), la Libye (2011) et la Syrie (2014). Ce qui est moins connu, c’est qu’entre 1992 et 2022, les États-Unis sont intervenus militairement 251 fois dans d’autres États (selon le service scientifique du Congrès américain), sans tenir compte ni des opérations de la CIA ni du soutien aux guerres par procuration. Il semble juste de supposer que la majorité de ces interventions ne s’est pas faite sous le couvert du droit international. L’ambition hégémonique des États-Unis, qui se base sur sa puissance militaire, ne fait pas bon ménage avec un droit international qui a pour fondement l’égalité des peuples et le principe de paix.
Mais un droit international n’a de sens que s’il est universel – donc équitablement valable pour tous les États. À travers ces centaines d’interventions contraires au droit international des États membres de l’OTAN, le droit international, bien avant l’attaque de la Russie en Ukraine a été piétiné et le reproche fait à la Russie semble malhonnête et discutable. Nous avons malheureusement pris l’habitude à l’Ouest d’accepter des standards différents pour nous-mêmes et pour « les autres ». C’est également la raison pour laquelle on parle volontiers au sein de l’OTAN d’un « ordre international basé sur des règles » fictif et non plus d’un droit international.
Un changement d’époque nous ramène-t-il au droit international ?
Mais les temps ont changé et les États-Unis, depuis longtemps, ne sont plus l’unique superpuissance militaire, économique, technologique et donc politique qu’ils étaient il y a encore 30 ans. Aujourd’hui, les États-Unis – et avec eux leur alliés européens – vont devoir se partager le pouvoir avec d’autres États dans le monde, un monde qui est déjà devenu multipolaire.
Et la croyance qui prévalait à l’époque – que les Etats-Unis, tels une force du bien et du progrès généraient grâce à leur puissance militaire un ordre mondial dans lequel la démocratie, l’État de droit et l’essor économique règneraient, ne s’est pas réalisée. Aucune des 251 interventions militaires, aucune des opérations de la CIA et aucune livraison d’armes dans les guerres par procuration n’a fait naître la démocratie, l’État de droit ou l’aisance économique. Elles n’ont semé que le chaos, l’anarchie, la ruine économique et sociale et une souffrance humaine incommensurable. C’est bien un destin semblable qui attend l’Ukraine. Car une ambition hégémonique et des armes n’apportent ni l’ordre ni la paix.
Peut-être que, précisément avec cette guerre insensée et inhumaine en Ukraine, nous nous rendrons à l’évidence que la Charte des Nations unies, qui déboucha sur le serment de tous les 193 États membres de ne plus jamais mener de guerre et de donner la priorité à davantage d’humanité dans les relations internationales, promet un avenir plus équitable, meilleur et plus pacifique pour l’humanité entière. Il ne nous reste plus qu’à avoir la volonté d’y adhérer pleinement !
Traduction : Laurence Wuillemin, Munich
En raison des crimes de guerre israéliens à Gaza, nous avons augmenté notre couverture de cinq à six jours par semaine. Nous n’avons pas les moyens de le faire, mais nous avons estimé que c’était la seule chose à faire. Si vous n’avez pas encore fait de don pour cette année, faites-le maintenant. Pour faire un don, rendez-vous ICI


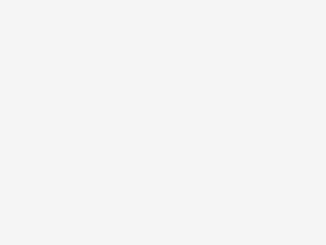
Be the first to comment